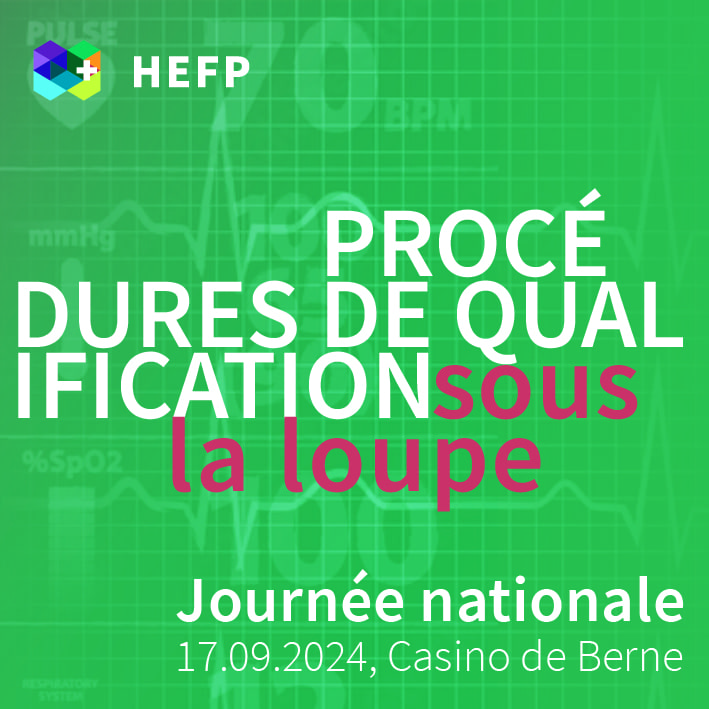Andreas Pfister à propos de son nouveau livre publié chez hep Verlag : « Neue Schweizer Bildung »
« Nous ne formons pas assez les jeunes »
On ne peut pas lui reprocher de redouter la confrontation : Andreas Pfister est professeur de gymnase et auteur. Il y a quatre ans, il exigeait la « maturité pour tous ». Aujourd’hui, dans son nouveau livre, il fournit d’autres arguments pour illustrer ce postulat. Qu’est-ce qui motive Andreas Pfister ? Le marché du travail a besoin de davantage de personnes diplômées d’universités, répond-il. Et le chemin est encore long avant que l’on puisse parler d’égalité en matière d’éducation.

Andreas Pfister: « Non, je n’ai pas l’impression d’être pris au sérieux par la formation professionnelle. » Photo | Daniel Fleischmann
Andreas Pfister, quelle est d’après vous la principale lacune de l’actuel système éducatif post-obligatoire ?
Le système éducatif post-obligatoire est en décalage par rapport à l’évolution économique et sociale. En 2021, 43 % des personnes exerçant une activité lucrative avaient une formation tertiaire, c’est trop peu, surtout si l’on considère le nombre de personnes ayant une formation universitaire. Le sommet académique de la pyramide du système éducatif est beaucoup trop étroit. C’est ce que confirme par exemple BAK Economics dans son récent rapport intitulé « Suisse 2035 ». Ce cabinet de conseil évoque les risques qui menacent la position de la Suisse comme pays innovant, parmi lesquels le « faible nombre de diplômés d’universités (notamment dans les sciences naturelles) en comparaison internationale. » Les recherches du SECO ou de l’Office de l’économie et du travail du canton de Zurich dressent également le même constat.
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
En 2016, le SECO a publié le rapport « Pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Suisse ». Celui-ci contient un « indice global d’évaluation de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée » dans lequel de nombreux emplois nécessitant une formation tertiaire figurent en tête de liste : Ingénieurs, techniciens, professions du management, professions judiciaires, professions de santé et métiers dans l’informatique. Bien sûr, cette liste est imprécise parce qu’elle mélange différents niveaux de qualification, par exemple dans les professions de santé. Mais le constat principal du rapport est confirmé par l’Office de l’économie et du travail du canton de Zurich. D’après l’étude « Métiers avec une forte pénurie de main-d’œuvre » publiée en 2016, quatre des cinq métiers affichant la plus forte pénurie de main-d’œuvre nécessitent une formation universitaire : médecins, ingénieurs, développeurs et analystes logiciels et diverses professions de santé avec une formation universitaire. Sur les 15 professions examinées qui ne sont pas concernées par une pénurie de main-d’œuvre, seule une est accessible avec des études universitaires : bibliothécaire / documentaliste.
Vous dites que l’évolution économique amplifie le besoin de personnes ayant une formation universitaire. Vous faites allusion à des processus comme la robotisation et la numérisation ?
Oui, j’appelle cela « Moderne 4.0 » dans une rubrique de mon livre. Mais les étiquettes s’effacent peu à peu ; le processus de numérisation fait déjà presque partie du passé, on pourrait maintenant parler de « numérique ».
Je voulais y venir : l’automatisation et la numérisation de l’économie sont une réalité depuis des décennies et l’éducation a suivi cette évolution. En 2011, seulement 32 % des personnes exerçant une activité lucrative avaient une formation tertiaire. Dix ans plus tard, comme vous l’avez dit, ce chiffre est de 43 %. C’est un rythme respectable !
Je ne veux absolument pas mettre en doute les performances du système de formation professionnelle : il s’adapte de manière dynamique aux besoins du marché du travail et garantit une bonne intégration des personnes sur le marché du travail.
Je ne veux absolument pas mettre en doute les performances du système de formation professionnelle : il s’adapte de manière dynamique aux besoins du marché du travail et garantit une bonne intégration des personnes sur le marché du travail. Malgré tout, le rythme est trop lent. De plus, je constate que la hausse que vous décrivez est dans une large mesure à mettre au crédit de l’arrivée de professionnels venus de l’étranger. Philippe Wanner et Ilka Steiner (Université de Genève) parlent d’une « augmentation spectaculaire de la migration hautement qualifiée en Suisse » : celle-ci a plus que doublé entre 1991 et 2014 et s’explique « principalement par le besoin de main-d’œuvre sur le marché du travail qui ne pouvait être satisfait avec les nouvelles générations d’actifs natifs de Suisse entrant dans la vie active ». Un autre chiffre doit être souligné : en 1990/1991, les « étudiants de nationalité étrangère n’ayant pas effectué leur scolarité en Suisse avant le début de leurs études » représentaient 13 % de la population étudiante. En 2020/21, ce chiffre était deux fois plus élevé.
À l’étranger, les personnes avec un niveau de qualification élevé ont une formation universitaire parce que, là-bas, on connaît très peu la formation professionnelle supérieure. Le problème est que des notions courantes comme le développement des compétences, les personnes hautement qualifiées ou la tertiarisation sont imprécises. Même les études que vous citez ne font pas la distinction entre la formation dispensée par les hautes écoles (tertiaire A) et la formation professionnelle supérieure (tertiaire B). Mais si l’on interroge des associations professionnelles comme Swissmem ou l’Union professionnelle suisse de l’automobile à propos de leurs besoins de main-d’œuvre qualifiée, leurs informations sont plus claires : « Nous avons besoin d’une main-d’œuvre bien formée, mais très peu de personnes avec un diplôme universitaire », disent-elles.
Ces associations ne déterminent pas à elles seules la demande. Le concept « Moderne 4.0 » dont je parle englobe la société dans son ensemble et inclut aussi la demande dans le secteur public. Dans le cadre de mes recherches, je me suis aussi entretenu avec un certain nombre d’associations professionnelles. L’impression que j’en retire : personne ne sait précisément de quels niveaux de qualification l’industrie, le commerce ou le secteur des services ont besoin. Le fait que certains secteurs de l’économie ne connaissent pas eux-mêmes leurs besoins en personnes diplômées d’universités doit nous inciter à réfléchir. Ce qui me frappe encore plus, c’est le fait que dans le discours sur la politique éducative, personne n’ose plus exiger un pourcentage plus élevé d’universitaires. C’est un terrain miné depuis que les Académies des sciences ont remis en question la formation professionnelle dans leur livre blanc « Éducation pour la Suisse du futur » publié en 2009. Mais lorsque vous recherchez des revendications en matière de politique d’éducation sur le site Internet de l’Union patronale, il est exclusivement question de formation professionnelle. La compétence des hautes écoles relève d’economiesuisse, pour ce qui est de la demande. Mais il est uniquement question de formation duale.
Le système éducatif enfreint aussi le principe d’égalité des chances, selon vous. Pour quelle raison ?
La prétendue perméabilité du système éducatif n’est pas atteinte dans les faits.
La prétendue perméabilité du système éducatif n’est pas atteinte dans les faits. Il y a trop peu de jeunes qui utilisent les passerelles entre les niveaux éducatifs. En 2020/21, à peine 2000 jeunes ont utilisé la passerelle – une voie par définition déjà étroite – entre la maturité professionnelle ou spécialisée et des études universitaires. On constate également que les personnes titulaires d’une maturité professionnelle se concentrent sur quelques métiers seulement. Les trois quarts se répartissent sur huit métiers CFC : électronicien/ne, laborantin/e, constructeur/trice, médiamaticien/ne, dessinateur/trice, informaticien/ne, automaticien/ne et employé/e de commerce. Qu’en est-il des autres professions ? La maturité professionnelle est en crise, de nombreuses entreprises formatrices refusent que leurs apprentis y participent. Elles agissent ainsi car la formation des apprentis fait partie du modèle d’affaires : les entreprises sont tributaires de l’utilité économique de leurs apprentis. Ce n’est pas une critique, c’est une réalité dont nous devons tenir compte.
Vous abordez très peu – ici non plus – la formation professionnelle supérieure et omettez de dire que les apprentis sans maturité peuvent aussi développer leurs qualifications.
Vous avez raison : la formation professionnelle supérieure offre d’intéressantes perspectives de carrière, elle promet parfois des salaires plus élevés que les parcours universitaires. Malgré tout, je pense que la maturité professionnelle, avec la place plus importante qu’elle accorde à l’enseignement scolaire, est la voie à suivre. La maturité professionnelle doit être rendue obligatoire. On parle beaucoup de responsabilité individuelle ; j’enseigne à des jeunes dans cet âge et je suis certain qu’ils ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité individuelle. Ils ont besoin de davantage de soutien.
Vous voulez pousser les jeunes vers l’enseignement tertiaire ?
D’une certaine manière, oui. Quand on a créé l’école primaire, on n’a pas laissé le choix aux parents ni aux enfants : la scolarité était devenue obligatoire. Ce n’est qu’ainsi que l’égalité des chances peut vraiment être garantie. En Suisse, les parcours scolaires restent moins influencés par des caractéristiques de performance que par des critères liés à l’origine sociale. Les études TREE le montrent clairement. Même lorsque l’on maîtrise les performances scolaires, l’origine sociale a une influence notable sur la répartition vers les différents types d’établissements scolaires. Cette répartition détermine dans une large mesure les filières de formation post-obligatoire vers lesquelles les élèves s’orientent. Il suffit de regarder dans chaque canton les pourcentages de jeunes qui décrochent une maturité pour se rendre compte à quel point l’égalité des chances est mise à mal dans le système éducatif suisse : dans le canton de Genève, un jeune sur trois obtient une maturité gymnasiale, contre un jeune sur huit dans le canton de Glaris. Les différences sont éloquentes, même en faisant abstraction de la frontière linguistique et culturelle entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Nous devons mettre un terme à de telles situations en rendant la maturité obligatoire. Cela ne suffit pas d’encourager uniquement une participation plus forte à la maturité professionnelle comme c’est le cas avec l’initiative Formation professionnelle 2030.
Dans votre livre, vous employez aussi la notion d’éducation humaniste. Pensez-vous que les étudiants dans la formation professionnelle en manquent ?
Oui. Les étudiants dans la formation professionnelle n’ont pas seulement une exigence de formation, mais aussi d’éducation. Les activités répétitives diminuent, alors que le besoin en personnes capables de prendre des initiatives augmente. La réflexion, les compétences méthodologiques, la capacité à dialoguer : ces compétences intellectuelles seront de plus en plus demandées. Penser est une activité à laquelle il faut s’exercer.
C’est aussi une chose courante dans la formation professionnelle : dans ce domaine aussi, on perçoit la nécessité urgente de développer les compétences transversales. Mais ce que vous exigez a une dimension surtout sur le plan du contenu : s’écarter des objets d’apprentissage spécialisés au profit d’une éducation humaniste en se penchant sur les œuvres de la littérature.
J’estime que l’éducation ne doit pas être mesurée uniquement à l’aune de son utilité économique. D’autres thèmes entrent en ligne de compte, comme la participation politique, la participation sociale, les questions sur son propre mode de vie (santé, famille) ou les thèmes écologiques.
D’une part, je pense que de tels contenus peuvent aussi être exploités dans des contextes professionnels, même s’il est impossible de le planifier. D’autre part, j’estime que l’éducation ne doit pas être mesurée uniquement à l’aune de son utilité économique. D’autres thèmes entrent en ligne de compte, comme la participation politique, la participation sociale, les questions sur son propre mode de vie (santé, famille) ou les thèmes écologiques. On voit aussi les choses de cette manière dans la formation professionnelle, où l’on a institué l’enseignement de la culture générale. Mais cette matière se trouve dans une situation difficile : ses défenseurs réclament depuis des années qu’elle soit mieux dotée, en vain.
Vous exigez une maturité pour tous. Quels effets attendez-vous de la participation à des formations supérieures ?
Si l’on remplit mieux le bagage scolaire des étudiants dans le niveau secondaire II, davantage de jeunes franchiront le pas vers une haute école ou une formation professionnelle supérieure ; les chiffres actuels le montrent déjà. Mais je ne peux pas donner de pourcentages.
Un effet possible serait que la formation professionnelle supérieure subisse un préjudice si tous les étudiants ont accès aux hautes écoles grâce à la maturité. Comment voulez-vous éviter cela ?
Je ne me pose pas cette question. Si nous voulons concevoir la formation des générations à venir, il ne doit pas y avoir de volonté de protéger les offres de formation actuelles. Si les jeunes optent pour des études universitaires à la place d’une formation professionnelle supérieure, alors c’est très bien ! Car nous n’avons pas seulement besoin de davantage de personnes qualifiées pour le marché du travail : nous devons aussi renforcer la place de recherche suisse.
Les exigences dans les filières de maturité sont élevées. Comment éviter que d’innombrables jeunes abandonnent leur formation en raison du niveau trop élevé ?
Je ne pense pas qu’il y aura de tels abandons. Ce qui compte, c’est de choisir une attitude qui fait en sorte que les étudiants puissent terminer avec succès leur scolarité. Je crois dans les jeunes et dans ce qu’ils sont capables de faire et je crois aussi dans l’effet puissant de la pédagogie. Pourquoi ? Parce que je constate qu’on a régulièrement parlé, dans différents contextes, d’un risque de baisse du niveau, mais cette baisse ne s’est pas encore produite. Dans les années 1950, seul un quart des jeunes effectuait un apprentissage. On s’inquiétait beaucoup du niveau à une époque on l’on faisait de l’apprentissage la norme générale. On peut développer des compétences dès lors qu’on les enseigne. Nos jeunes ne sont pas au bout de leurs capacités intellectuelles, mais nous les formons trop peu. Je souhaite que l’on cesse de faire venir dans le pays des personnes hautement qualifiées. Au lieu de cela, on doit enfin créer les conditions pour que notre jeunesse puisse participer au développement du pays.
On devra nécessairement abaisser le niveau pour qu’une grande majorité des étudiants puisse obtenir la maturité.
Derrière cette prévision, je perçois un certain scepticisme à l’égard de la culture éducative et scolaire et ses possibilités. Ce scepticisme est d’ailleurs très marqué en Suisse. Mais avec cette attitude, on freine la jeunesse de son pays. Malgré tout, je comprends vos craintes dans une certaine mesure. Je propose donc de diviser la maturité professionnelle selon le modèle du niveau secondaire I en deux niveaux de performances pour prendre en compte les possibilités des étudiants plus faibles. De plus, sont exclus de l’obligation d’effectuer une maturité les étudiants qui suivent une formation initiale en deux ans. Si l’on relève les exigences scolaires, on peut envisager une légère augmentation du nombre d’étudiants dans une formation professionnelle initiale avec attestation fédérale.
Mais le système éducatif présente déjà cette distinction : des parcours universitaires pour les détenteurs et détentrices d’une maturité et, grâce à la formation professionnelle supérieure, des perspectives de carrière intactes pour les jeunes qui sont peu intéressés par l’école. Vos propositions mettent en péril ce système qui a fait ses preuves et qui est en outre perfectionné en permanence. Ainsi, des efforts sont menés dans la politique éducative pour augmenter les pourcentages d’étudiants avec une maturité professionnelle.
Les efforts de la politique éducative sont vains. Dans le même temps, les pourcentages d’étudiants avec une maturité gymnasiales sont pratiquement gelés et la participation à des formations universitaires est même en légère baisse. Je le répète : ce qui me tient à cœur, c’est de développer la formation scolaire, à tous les niveaux.
La proposition de renforcer la culture générale entraîne un affaiblissement de la formation professionnelle. Comment voulez-vous convaincre les entreprises de cette régression des compétences ?
Mais je ne sais pas combien d’entreprises sont réellement en difficulté au point d’arrêter leur pratique de formation si leurs apprentis s’absentent une demi-journée ou une journée entière pour suivre les cours à l’école.
C’est une question difficile pour laquelle je n’ai pas de solution toute faite. Mais est-il préférable de ne rien changer, en privant les jeunes d’éducation ? Une chose est sûre : il faut prendre au sérieux la situation économique des entreprises formatrices. Je propose donc la mise en place de frais d’apprentissage qui compensent les pertes de rentabilité liées à une absence prolongée des apprentis. Une telle aide financière a déjà été mise en place dans la formation professionnelle supérieure avec le financement axé sur la personne. Mais je ne sais pas combien d’entreprises sont réellement en difficulté au point d’arrêter leur pratique de formation si leurs apprentis s’absentent une demi-journée ou une journée entière pour suivre les cours à l’école. En Allemagne, on forme des apprentis même lorsque la formation n’est pas rentable. En formant la relève, les entreprises savent qu’elles s’épargnent le difficile processus de recrutement de la main-d’œuvre.
Vos propositions sont radicales. Avez-vous le sentiment d’être pris au sérieux par les représentants et représentantes de la formation professionnelle ?
Non, je n’en ai pas l’impression. On secoue la tête et on constate que je viens du milieu universitaire. Cela vient peut-être du fait que, pendant longtemps, les universités n’ont pas suffisamment pris au sérieux la formation professionnelle. Il faut rompre avec ce manque de dialogue. Je propose donc de réorganiser la gouvernance, comme c’est en partie le cas dans la réforme actuelle du gymnase. Nous avons besoin d’une structure supérieure dans laquelle on peut discuter, sans préjugé et de manière désintéressée, de la question de la bonne éducation en vue du modèle Moderne 4.0. Ces dernières décennies, la formation professionnelle a considérablement rehaussé son image ; c’est une grande performance. Mais à présent, le discours a basculé dans le sens inverse : nous sommes désormais dans une situation dans laquelle même les milieux universitaires évoquent le nombre d’étudiants qui n’ont rien à faire au gymnase ou qui « se la coulent douce ». Tout cela est dangereux pour la place scientifique et économique suisse.
Citation
Fleischmann, D. (2022). « Nous ne formons pas assez les jeunes ». Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 7.